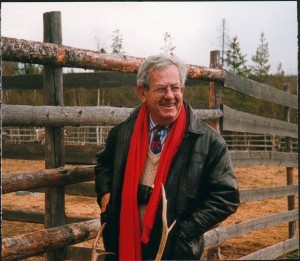On n’environne bien que de près
Auteur:Serge Antoine
Source : article de la revue « vie publique 1974 » p 71-73 1974
Secrétaire général du Haut comité pour l’Environnement, Serge Antoine est aussi maire adjoint de Bièvres. À ce titre, il répond aux questions précises que se posent les élus locaux à propos de l’environnement. Il leur donne des informations utiles et des conseils pratiques.
Pour un maire, l’environnement est-il une mode, un luxe, un mot un peu vide de sens, une réalité ?
Je ne crois pas du tout que l’environnement soit une mode ; l’environnement est un problème qui, sous-jacent à toutes les sociétés, a simplement empiré et s’est donc révélé à partir du moment où l’on s’en est moins soucié ; ce qui a été souvent le cas dans les cent dernières années.
Pour la seule lutte antipollution, nous en avons pour 20 ans à réparer cet oubli.
Quant à être un luxe, tout dépend de la définition que l’on donne de l’environnement. S’il s’agit de protéger l’espace de quelques privilégiés pour disposer seuls de 50 hectares et avoir, sans la foule, les pieds dans l’eau ; là, il y a luxe. Mais, si l’environnement est défini pour le plus grand nombre et qu’il se réfère aux taudis des immigrants, aux inadaptés de notre société urbaine, aux milliers de morts du Sahel sec, ou à la santé d’une génération, alors ce n’est pas un luxe ; pas plus que les 100 000 réveillés la nuit par une auto mal réglée, ni que les morts du week-end qui ont fuit la ville que l’on n’aime plus. Je pense que si l’on disposait d’une bonne comptabilité qui fasse vraiment entrer en ligne de compte la santé des habitants, et leur bien-être, alors personne ne parlerait de luxe. D’ailleurs, les municipalités en parlent-elles ? Lorsqu’elles élaborent un plan d’occupation des sols, lorsqu’elles plantent une allée de tilleuls, organisent une fête ou prévoient des bancs sur les places publiques, elles font de l’environnement sans le dire : elles ne parlent pas de luxe !
D’ailleurs, l’environnement coûte-t-il cher ? Cela n’est pas évident. Il y a d’abord un certain nombre de mesures qui ne coûtent rien et celles dont le prix n’est pas très élevé. Ce sont toutes les mesures de réglementation, par exemple : élaboration d’un plan d’urbanisme, contrôle, interdiction. Lorsqu’on arrête un véhicule parce qu’il fait du bruit ou parce qu’il est trop polluant, cela ne coûte pas cher au maire de le faire et cela peut contribuer au repos de toute une ville.
Ensuite, il y a des mesures qui ne sont pas directement prises en charge par les collectivités ; le ravalement, par exemple, est mis à la charge des propriétaires.
Le souci du micro-environnement ne coûte pas très cher : mettre un banc public à l’endroit où il faut, faire en sorte que la personne handicapée ou âgée puisse marcher sans avoir à gravir un escalier, planter des arbres à l’endroit où l’on voudrait qu’il fasse frais ; tout cela n’est pas d’un coût très élevé. Les dépenses de plantation devraient être une opération courante ; la comptabilité française ne classe-t-elle pas les dépenses de plantation parmi les dépenses de fonctionnement d’une commune et non dans les dépenses d’investissement ?
Ces petites actions, ces attentions, à mon sens, sont de l’ordre de ce que seule la mairie peut concevoir et réaliser ; si elle ne le fait pas, personne d’autre ne le fera. La commune est donc la mieux placée, aidée parfois – ce qui est pédagogiquement intéressant – par la population qui peut prendre goût à ce genre de choses. S’il y a une dimension dans laquelle la participation active de la population peut s’exercer (je pense, par exemple, aux « commissions élargies »), c’est bien l’environnement, au même titre d’ailleurs que les problèmes scolaires.
Bien sûr, il peut y avoir des dépenses plus chères, par exemple, pour acquérir des espaces verts qui risqueraient de disparaître. Mais, d’une part, cette acquisition a valeur d’épargne ; d’autre part, il peut y avoir, du moins pour le cas des grands ensembles verts à protéger, des aides des départements (très variables d’ailleurs selon les départements) ou de l’État.
Vous pensez donc qu’un maire doit avoir une politique de protection de l’environnement, mais est-ce simplement une somme de petites attentions, de préoccupations quotidiennes ?
Non, il y a les deux.
La vision globale est nécessaire ; le plan d’occupation des sols, par exemple, est utile pour la vision totale de la ville. Il ne peut pas y avoir d’environnement s’il n’y a pas une certaine conception d’ensemble, 10, 20 ou 30 ans à l’avance de ce que peut devenir une commune et si la population ne sent pas dans quelle direction globale elle va ou peut aller. Je crois que c’est très important et que cette attitude prospective se développe en France depuis quelques années.
Mais, en même temps, l’environnement, c’est aussi une somme de petites attentions. Il ne peut y avoir l’un sans l’autre. S’il n’y avait que le Pos, je dirais que l’environnement d’une commune pourrait être totalement « raté » ; car, dans le Pos, on ne voit ni les piétons, ni les bancs, ni la manière dont les femmes attendent à la sortie des écoles, ni les fêtes. Le coefficient 0,15 ou 0,20 n’explique pas tout.
Si on n’entre pas dans l’environnement par ces deux approches ; je crois qu’on n’a pas compris ce qu’était l’environnement.
Napoléon ne disait-il pas : « On peut gouverner de loin mais on n’administre bien que de près. » On pourrait dire maintenant : « On n’environne bien que de près. » La véritable qualité des communes, c’est qu’elles sont proches de l’habitant, et qu’elles peuvent à la fois disposer d’une vue globale et aussi avoir des attentions pour l’habitant et son environnement vécu et immédiat.
C’est dans cette perspective que plutôt que de tendre à la création de services nouveaux, le ministère de la Protection de la nature et de l’Environnement a, en liaison avec celui de l’Équipement et celui des Affaires culturelles, mis sur pied des « équipes mobiles » qui, à la demande des maires des villes moyennes, se rendent sur place avec un camion équipé pour les aider dans la reconnaissance de certains problèmes de micro-environnement.
Je reconnais toutefois que, leur territoire étant parfois exigu ou partiel, les communes n’ont pas toujours le moyen d’avoir une vue globale suffisante ; c’est pourquoi je pense que, dans certains cas, les données géographiques pourraient mieux être prises en compte grâce à l’appui qu’elles peuvent se donner dans les syndicats de communes ; les syndicats de montagne ou de vallée sont utiles pour restituer la vision globale. Les parcs naturels régionaux ne sont pas autre chose qu’un grand syndicat intercommunal (qui comprend quelquefois 60 communes) conçu non seulement pour une défense de territoire, mais aussi en vue d’une certaine vocation de l’environnement.
Mettre un tigre dans son moteur
Vous engageriez des communes à faire des syndicats pour la protection de l’environnement ?
J’engagerai les communes d’abord à se servir des syndicats qui existent et à mettre plus d’environnement dans leurs syndicats comme on met un « tigre dans son moteur » Les syndicats d’assainissement peuvent être aussi des syndicats de protection de rivières et de promenades le long de la rivière et pas seulement des instruments pour le curage. Il faut d’abord se servir de ceux qui existent. Ne reflètent-ils pas déjà une réelle communauté de proximité ou de voisinage qui peut correspondre à une certaine unité de paysage ; les syndicats d’assainissement sont des syndicats de rivière et les syndicats de rivière sont des syndicats de géographie physique et humaine, donc potentiellement d’environnement.
En ce qui concerne les ordures ménagères et l’eau, il y a une législation et des structures organisées ; en revanche en ce qui concerne l’air, le bruit, il n’y a rien. Comment cela se fait ? Que doit faire le maire ?
Quand on est maire, c’est vrai, on est toujours un peu isolé. Entre l’Administration centrale, lointaine et la municipalité, il y a des institutions sur lesquelles il peut prendre appui mais elles n’existent pas toujours.
Pour l’eau, depuis la loi de 1964, six agences de bassin ont été créées qui groupent maintenant 500 employés et dont les adresses commencent à être connues des maires, non seulement par les cotisations qu’ils versent mais aussi à cause des services que ces agences de bassins donnent pour l’épuration, la pollution ; il aura fallu 10 ans pour que l’eau ait ses structures et que les agences puissent être les conseillères des collectivités.
Pour les déchets, on y arrive. Le ministère de la Protection de la Nature y pousse au niveau du département. Les communes auront donc bientôt d’autres conseillers que les fournisseurs pour le ramassage ou le traitement, fournisseurs qui ne tiennent pas toujours compte des situations différentes entre régions, entre petites et grandes villes.
Pour l’air, nous ne savons pas encore quelles structures seront mises en place. Aux États-Unis, à côté des agences de bassin pour l’eau, des agences de l’air ont été créées qui s’identifient souvent à des régions urbaines. En tout cas, pour l’air en France, il existe déjà des hommes, les inspecteurs des établissements classés (ils sont maintenant environ 250). Quant aux instruments de mesure, ils se mettent en place ; des réseaux de mesure fonctionnent pour la Basse-Seine. Ils vont être développés en région parisienne et, en 1978, couvriront les grandes zones urbaines du territoire.
Pour le bruit, le problème est difficile parce qu’on entre dans un domaine plus subjectif et qu’il y a des sources très différenciées : bruit des aérodromes, bruit des voitures, etc. Pour ces dernières, on a créé des brigades mobiles de contrôle ; le bruit des logements de son côté, appelle une action spécialisée, menée à partir du « label de qualité » et relayée par l’Institut national de la consommation. Le bruit est donc réparti entre un certain nombre de branches et je conçois que, pour le maire et les collectivités locales, ce ne soit pas très facile ; d’où la nécessité d’une information ou d’un « guide de bruit » que le ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement est en train de préparer pour aider les maires.
Les réserves foncières : un bon placement
Outre la lutte antipollution, il y a aussi les loisirs, les promenades. Que pensez-vous du rôle des communes à cet égard, notamment quant au patrimoine· foncier et aux chemins de randonnée, par exemple ?
Le patrimoine des collectivités est, hélas, très faible en France, hors les régions de montagne, l’Alsace, les Landes. Ces patrimoines ont pourtant une grande importance pour la protection de l’environnement. L’acquisition de réserves foncières est une bonne chose : c’est un placement. À l’inverse, l’aliénation de biens, même s’ils ne correspondent plus tout à fait aux fonctions économiques pour lesquelles ils sont autrefois entrés dans la communauté, peut être préjudiciable.
Parmi ces territoires, il y a les territoires de cheminement qui correspondaient autrefois à des chemins ruraux desservant des activités rurales, zones libres entre des champs. Si l’on veut promouvoir une politique de cheminement de piétons dans les zones périurbaines et en milieu rural, si l’on veut faciliter la randonnée, encore faut-il que des chemins existent. Comme les propriétaires n’ont plus le même intérêt pour respecter les passages (le remembrement le traduit d’ailleurs) si les collectivités, elles, ne conservent pas ces sentiers dans leur domaine, qu’il soit privé ou public, eh bien, le piéton ne passera plus. Dans la réalité comme sur les cadastres, la géographie devient impénétrable. J’ai regardé au mois d’août par curiosité le cadastre de Toulon élaboré il y a 20 ou 30 ans et celui qui a été refait par les géomètres contemporains. L’actuel est fait de telle manière qu’il n’y a plus aucun cheminement à l’intérieur de toute la périphérie de la ville, alors qu’autrefois il y avait du terrain neutre, des servitudes de passage ; chacun n’était pas comptable de son terrain de la même manière que maintenant.
Il faut encourager les collectivités à recenser (comme elles en étaient tenues autrefois tous les cinq ans) leurs chemins ruraux, à les laisser ouverts, à les faire connaître, à les baliser, à les entretenir pour que le piéton puisse passer. C’est un tout petit effort pour les communes, mais c’est un effort productif pour l’accueil et la sympathie d’une collectivité.
À vous écouter, vous attendez beaucoup des communes et qu’elles jouent un rôle de relais de la politique de l’environnement ?
Oui, mais je ne crois pas qu’il y ait de niveau privilégié de l’environnement ni d’exclusivité. L’environnement doit s’ancrer partout, à tous les niveaux et ne pas avoir de domaine propre. Ceci étant, il faut choisir le bon niveau pour la réponse à ces problèmes très différents. Au niveau mondial, par exemple, la politique française consiste à bien déceler les problèmes réellement planétaires : par exemple, la gestion des océans orphelins car, si l’Onu ne s’en occupe pas, nous risquons de voir mourir les océans (l’Onu n’a pas, par contre, à régir toute une série de décisions qui peuvent être prises au niveau national ou au niveau régional). L’échelon le plus petit doit, a priori, être préféré si l’on veut éviter la centralisation.
Revenons en France, le département a un rôle actif à jouer, la région aussi ; c’est une collectivité qui se crée et il ne faudrait pas que cette collectivité soit uniquement mue par un souci de développement et de progrès mal compris c’est-à-dire où l’on n’intègre pas l’environnement. Une collectivité du xxe siècle, comme l’est la région, si elle est uniquement « motivée » par le développement, au sens étroit du mot, si elle n’intègre pas convenablement l’environnement, « ratera » sa mission.
Ceci dit, si je suis si attaché aux communes, c’est parce qu’elles ont l’avantage d’être près de l’habitant, de sentir ses problèmes. Or, bien souvent les problèmes de l’environnement ne sont pas seulement des problèmes de pollution, ce sont des problèmes de relation de l’homme avec son milieu. Si quelque chose ne va pas dans les villes, c’est parce que souvent l’homme ne sait plus vivre en milieu urbain et qu’il doit réapprendre (c’est un mot qu’utilisait souvent Louis Armand) « la grammaire quotidienne », c’est-à-dire les règles de conjugaison, de l’homme avec son milieu, ville ou campagne.